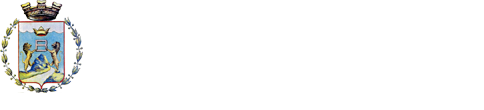FILAGE, LAINES ET COUTURE
Cette partie présente toute une série d’objets très variés qui nous racontent l’évolution de certains aspects de la production textile, tant domestique que spécialisée, entre le XIXe et le XXe siècle.
A côté de l’entrée, on aperçoit, sur la table, divers outils de couture. En plus des ciseaux à tissu, on remarque de nombreux fers à repasser en fer forgé ou en fonte, équipés d’un compartiment à braises, destiné à préserver leur chaleur. S’il s’agit d’objets couramment utilisés dans la première moitié du XXe siècle, ils étaient toutefois déjà répandus à la fin du XIXe siècle. On trouve ainsi des fers à repasser d’atelier de couture (comme les grands modèles dont certains pèsent 9 kilos) et toute une série de fers plus petits toujours alimentés à la braise, utilisés dans les foyers jusque dans les années 1970 et même au-delà.
On remarque ensuite de nombreux objets liés au filage de la laine, qui était pratiqué et répandu dans tous les foyers. Au sein des groupes familiaux, les femmes se chargeaient souvent des différentes étapes de transformation de cette matière.
Les pesons et fuseaux en bois exposés ici étaient utilisés pour sortir le fil de la masse de laine. Celui-ci était mis en écheveaux et pelotes que l’on utilisait ensuite en phase de tissage. Pour les métiers à tisser en bois, on utilisait des outils caractérisés par deux pointes aux extrémités, ayant une forme qui n’est pas sans rappeler celle d’une barque. Il s’agit des navettes, auxquelles était fixé le fil, qui pouvait être déplacé d’un côté à l’autre de la surface de travail lors du tissage.
Il est fort probable que la laine utilisée dans les productions domestiques jusqu’à la première moitié du XXe siècle, provenait des moutons (y compris en transhumance) qui paissaient dans les prés entourant ces zones habitées. La laine a longtemps représenté l’une des matières centrales du filage et du tissage dans les hautes vallées ligures. Des activités qui ont été progressivement abandonnées entre la première et la seconde moitié du XXe siècle, les laines déjà transformées étant plus faciles à trouver et les laines brutes locales disparaissant. Le lin, le chanvre et même le coton constituaient d’autres matières travaillées dans une moindre mesure.
Les machines à tricoter exposées ici, nous montrent l’évolution de l’activité de tissage, notamment au sein des foyers. A partir du milieu du XXe siècle, ces machines se sont répandues non seulement à Montebruno et Torriglia, mais aussi dans de nombreux foyers de notre péninsule et bien au-delà. Entre les années 1950 et 1960, l’Italie du Nord a connu une forte croissance du commerce et de la production textile, qui a impliqué les productions domestiques tant dans les plaines que dans les zones de montagne, en contribuant ainsi à augmenter le revenu des familles de façon plus ou moins importante. En effet, les articles tricotés ainsi produits n’étaient pas uniquement destinés à la famille, mais visaient surtout à approvisionner de plus grandes chaînes de production dans la vallée et les villes.
Face aux machines à tricoter, on remarquera les machines à coudre les plus connues qui, dans la première moitié du XXe siècle, se sont répandues dans tous les foyers. Là encore, les différents modèles exposés permettent d’appréhender les mutations et la mécanisation progressive de cette activité.
Devant les machines à coudre se trouve l’un des nombreux pressoirs à cidre exposés dans le musée, témoignant de la diffusion de cette boisson obtenue à partir du pressurage des pommes.